Thomas Sotto nous répond:
Pendant cet entretien, les élèves et les enseignants ont posé un certain nombre de questions. Voici quelques réponses données par Thomas Sotto…
Neela: Quel est votre parcours ? Pourquoi avez-vous choisi d’être journaliste ?
Thomas Sotto commence par nous expliquer qu’il n’a jamais vraiment choisi d’être
journaliste. En effet, il a toujours eu envie de faire ce métier étant enfant, pour « aller
là où les choses se passent ». Il nous raconte que ses parents (père commerçant)
lisaient beaucoup la presse et que, baigné dans cet univers depuis toujours, il s’est
rapidement mis à créer ses propres journaux.
Il effectue une première scientifique, puis se lance dans le droit. Un jour, il croise
dans la rue le journaliste Bruno Masure, qui lui donne le conseil, pour devenir
journaliste, de se constituer le maximum de culture générale. Thomas Sotto fait donc
sa licence en droit et une maitrise SE puis passe un concours pour devenir
journaliste. Il fait beaucoup de stages, comme à RMC par exemple.
Par la suite, il travaille au pôle reporter de BFMTV pendant six/sept ans, pendant
lesquels il est beaucoup sur le terrain. Après ça, il devient rédacteur en chef à M6
pendant trois/quatre ans, et est aujourd’hui dans l’émission politique de France 2
depuis 2017.
Charlotte: Pourquoi selon vous l’image peut-elle être plus forte que le mots ?Il répond que c’est une bonne question, il pense que nous avons besoin des deux. Une image peut mentir un mot également. C’est pourquoi, pour lui, il faut toujours vérifier ses sources et ses informations, comme le fait la télévision. De plus, aujourd’hui la vérité devient une opinion et il faut être de plus en plus vigilant selon lui.
Adrien: Quelle(s) précaution(s) apportez-vous lorsque vous utilisez des images pour
illustrer vos propos ?
Thomas Sotto nous explique qu’ils vérifient les images (quel jour ? Quel endroit ?
etc.), les sourcent en amont, mais font aussi attention à vérifier s’ils en ont les droits
ou pas, et quand ce n’est pas le cas, les achètent. En revanche, lorsqu’elles
parviennent de leurs propres journalistes, cela ne pose aucun souci, pas besoin de
vérifier !
Adrien: Quelle place doit tenir l’image dans l’information ?
Thomas Sotto nous répond d’abord qu’aujourd’hui les images sont partout, et qu’en
conséquence la question ne se pose même pas. Ce qui importe le plus serait plutôt
notre rapport à l’image, « c’est à vous d’avoir l’esprit critique » nous recommande-t-
il. Il nous faut douter de l’image, ne pas la gober, sans rentrer dans l’extrême inverse,
le complotisme. Thomas Sotto nous parle ensuite des « Deepfake » ces images
générées par l’intelligence artificielle qui « peuvent faire dire aux gens n’importe
quoi », et nous expliquent que les médias ont, pour y faire face et les contrer, des
« armées » de vérificateurs, qui s’enquièrent de la source et de la véracité des images.
Jean: Peut on parler de la preuve par l’image ? Doit on se méfier de l’intelligence artificielle ?Pour Thomas Sotto, il faut être vigilant et attentif, il n’est pas forcément très rassuré.Cependant, il pense que tout finit plus ou moins par se réguler et qu’il suffit de laisser faire les choses. L’intelligence artificielle c’est compliqué selon lui, mais pas forcément néfaste.
Dans son métier, la clé c’est la source, or celle ci n’est pas donnée avec l’ Intelligence Artificielle.
Jean: Existe il une différence entre les journalistes de télévision et les autres ? Le journaliste de télévision, c ‘est le miroir du métier, selon Thomas Sotto. Cependant derrière la caméra se cache le même métier, il faut trouver et rechercher les informations. Ainsi, il pense et exprime que d’après lui présentateur n’est pas un métier. Il faut d’abord avoir fait du terrain, car c’est le sens même du métier : regarder à 360°, oublier ses préjugés et raconter ce que l’on voit.
M. Le Gall : Les citoyens français sont-ils, d’après vous, en capacité d’analyser et de réagir correctement face aux informations qui leur parviennent ?
Thomas Sotto déplore que non, malheureusement, aujourd’hui la population française n’est absolument pas assez éduquée aux médias, même si les jeunes le sont maintenant davantage que leurs aînés, car sachant y faire avec les technologies. Lui serait pour une réelle « éducation aux médias » dès l’école primaire, afin d’apprendre à décoder l’image au lieu de se faire manipuler par cette dernière. Il pense d’ailleurs que c’est quelque chose de tout à fait envisageable avec « cette armée formidable » que sont les professeurs.

Thimothée : Comment faites-vous avec la concurrence, la pression de toujours être les premiers dans l’information ?
Thomas Sotto nous répond que lui préfère la prudence et la vérification des images avant tout, quitte à être le troisième ou le quatrième dans l’information. Pour illustrer ses propos, il nous raconte le jour où ils tombent sur cette vidéo d’un avion attaqué par des Israéliens… à 19h55. Les cinq minutes ne suffisent pas à la vérification complète de la vidéo, ils n’en parlent pas. C’est très frustrant, bien sûr, mais ils ne peuvent pas se permettre de montrer aux téléspectateurs des images dont la source et la véracité de ce qu’elles montrent ne sont pas vérifiées.
M. Le Gall : Comment faites-vous par rapport à ce qui se passe au Proche-Orient et à la difficulté d’avoir des images ?
Tomas Sotto confirme qu’en effet, les premiers jours de ce conflit, ils étaient dans l’incapacité d’avoir des images, mais que leur devoir était de quand même d’en parler. En conséquence, ils se devaient d’être extrêmement prudents dans leurs informations, notamment celles concernant le bilan humain du Hamas, le risque étant que tout ça ne soit que propagande et fausse information. Thomas Sotto nous explique ensuite que, bien que cela puisse paraître étonnant, dire « je ne sais pas » était très important dans leur métier, et que l’emploi du conditionnel est également très utilisé. En effet, le « contrat de confiance » passé entre les téléspectateurs et eux, les journalistes et leur média, met beaucoup de temps à se construire, et il peut se détruire très rapidement. En conséquence, il leur faut être honnête dans leurs sources.
M. Le Gall : Sur ce type de conflits, être objectif est très compliqué, vous pesez chaque mot ?
M. Sotto admet que oui, c’est bien le cas, mais qu’en même temps, leur conscience professionnelle et leur devoir d’être le plus honnête possible font qu’ils, enfin lui pour sa part, n’y pensent pas, et ne se soucient pas de ce que vont penser les gens.
M. Le Gall : Pourriez-vous nous expliquer comment votre interview avec le porte-parole de l’ambassade russe s’est-elle passée pour vous ?
Thomas Sotto relate qu’il a poussé Alexander Makogonov dans ses derniers retranchements, car lui savait pertinemment que ce dernier disait des choses totalement fausses, ce qui l’a agacé et l’a déterminé, « peut-être un peu trop » avoue-t-il. De plus, en tant que journaliste, il ne peut pas laisser passer de fausses informations, car au-delà de la conscience professionnelle, il est responsable de ce qui est dit sur le plateau. Mais il nuance en nous expliquant que ces moments tendus ont eux aussi leur importance dans les interviews. De plus, M. Sotto fait la différence entre les interviews (ce qu’il fait) et les débats, les deux ne se confondant pas. Il nous apprend par ailleurs que lui ne se considère pas comme égal à la personne invitée.
« Nous, on se dit que si un Homme politique repart content, c’est qu’on a mal fait l’interview » conclut-il par un trait d’humour.
L’interview d’Alexander Makogonov par Thomas Sotto. A vous de la regarder…
https://www.youtube.com/watch?v=qeeaVZnFWJc
M. Le Gall : Par rapport aux politiques, justement, n’est-il pas difficile de poser les bonnes questions au bon moment et de pousser sans trop pousser ?
Thomas Sotto répond qu’en tant que journaliste et pour les téléspectateurs, il est très important d’obtenir des réponses… voir des non-réponses ! En effet, les silences, nous explique-t-il, sont très révélateurs, et lorsqu’il pose cinq fois la même question et que l’invité ne lui répond toujours pas, parlant d’autre chose, détournant la conversation par quelques subterfuges, cela veut tout dire : il ne veut pas répondre. Il nous parle d’ailleurs de certains politiques qui tentent de complétement prendre le contrôle de l’interview, commençant dès le début par parler d’autre chose, de ce qui les intéresse et les arrange uniquement…
M. Le Gall : Comment choisissez-vous vos invités ? Est-ce un choix collectif ?
M. Sotto explique que leurs invités sont choisis en fonction de l’actualité, et en aucun cas en fonction des sondages, même s’ils les consultent afin de s’assurer de ne pas être en total décalage.

Adrien : Est-ce qu’il vous arrive de ne pas rentrer chez vous pour dormir certains jours ?
« Oui, aujourd’hui par exemple ! » répond Thomas Sotto, qui paraît en effet très fatigué mais qui a quand même pris la peine de venir nous rencontrer. Il nous confie par ailleurs qu’il lui arrive parfois de regarder les matchs de foot le soir, au détriment de son sommeil… Mais il considère qu’une bonne soirée entraîne une « bonne fatigue » et que cela en vaut la peine. Il s’enquiert par la suite de savoir si certains d’entre nous sont fans de football, et si oui, qui il supportent.
M. Le Gall : Avez-vous un positionnement différent sur le 20h et sur Télématin ?
Thomas Sotto nous explique que bien que les deux émissions soient différentes, l’approche reste la même. En revanche, ce qui est intéressant c’est la construction qu’il y a autour, la manière de présenter les choses. Il estime que ça, c’est la cerise sur le gâteau.
M. Le Gall : Faites-vous le bilan de l’audimat après le 20h ?
M. Sotto nous répond que le bilan de l’audimat arrive le lendemain (à 9h, précise-t-il), donc qu’ils ne peuvent pas le faire le soir même, mais qu’en revanche, ils font un debriefing juste après. Assez rapidement d’ailleurs, car tout le monde est fatigué et veut rentrer chez soi, nous confie-t-il.
M. Le Gall : Est-ce une chance pour vous que l’émission « Plus belle la vie » ait disparue ?
Thomas Sotto nous répond que cela n’a pas changé grand-chose. En effet, avant, explique-t-il, les gens quittaient le 20h à 20h20 pour aller regarder l’émission en question, mais aujourd’hui, l’audimat n’a pas changé, personne ne sait où sont passés ces téléspectateurs…
M. Le Gall : Y a-t-il une différence entre le privé et le public dans le journalisme ?
Thomas Sotto nous raconte que, heureusement pour lui, partout où il est passé durant sa carrière, il n’a jamais reçu une quelconque pression quant aux thèmes abordés, et ce aussi bien dans le public que dans le privé.
Adrien : L’image que vous avez des invités change-t-elle après une interview ?
M. Sotto nous répond que bien sûr, que ça soit en bien ou en mal, l’image qu’il a de certaines personnes peut changer, car ses interviews restent avant tout des rencontres humaines. Il estime que c’est d’ailleurs tout à fait normal, que cela prouve que tu as réellement écouté ce que la personne en face te disait.
M. Le Gall : Etes-vous influencé par la pensée de défendre la démocratie ? Quel est votre ressenti par rapport à cela ?
Thomas Sotto répond en expliquant d’abord que lui, dans son entourage, personne ne sait pour qui est-ce qu’il vote, et qu’il fait bien attention à dissocier en lui le citoyen du présentateur qui lui, se veut neutre et objectif. Dans son métier, sa limite reste le Droit et la loi, il n’est pas là pour dire pour qui est-ce qu’il faut voter, même si parfois, l’envie lui prend de glisser dans ses interviews quelques-unes de ses idées politiques.
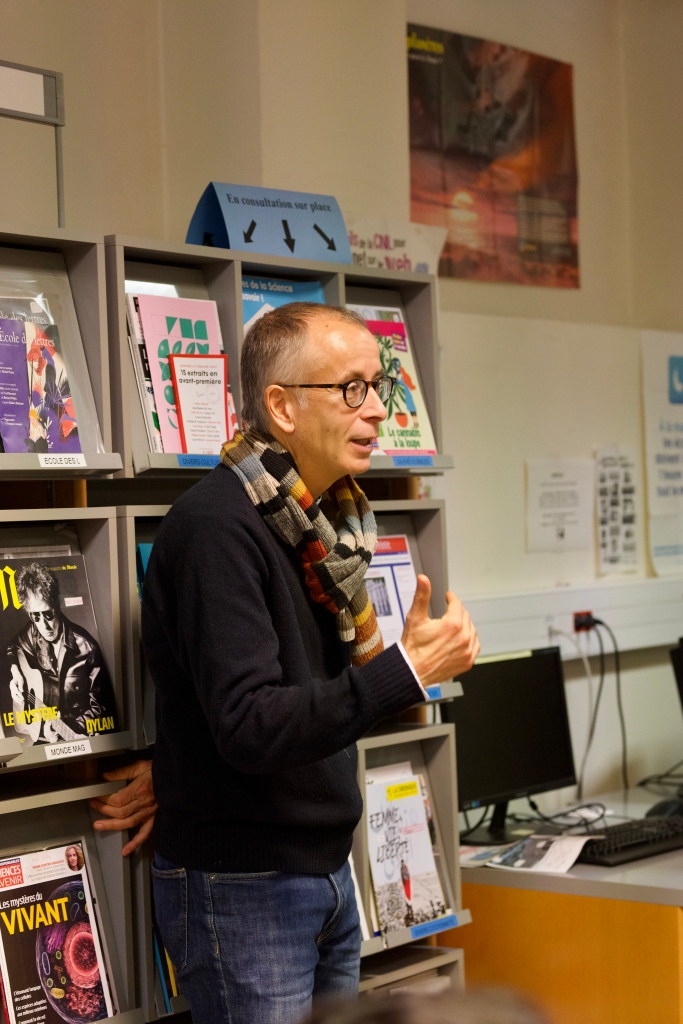
M. Le Gall : Que pensez-vous de l’information par les réseaux sociaux ?
Thomas Sotto répond d’abord en critiquant tout particulièrement le réseau social « X » (anciennement Twitter), qu’il qualifie de « ramassis de bêtises », avec en plus la disparition des comptes officiels (des médias et personnalités politiques par exemple) certifiés, tout le monde pouvant désormais acquérir cette certification, rien qu’en l’achetant.
Mais il précise ensuite que les informations faites sérieusement par les jeunes sur les réseaux sociaux, comme le journaliste Hugo Décrypte, valent tout autant que celles faites par « les moins jeunes ». Il ajoute également que ce n’est pas parce que lui est journaliste qu’il pose forcément les bonnes questions.
Mais le réel problème de l’information par les réseaux sociaux, explique Thomas Sotto, c’est que les sujets abordés ne dépassent pas 30 secondes ou six lignes d’explication, et que c’est bien trop peu pour pouvoir affirmer maîtriser un sujet. Cela peut entraîner, par le manque d’éléments, de la désinformation. Thomas Sotto nous met donc en garde, nous invitant à toujours vérifier les informations qu’on rencontre, particulièrement celles des réseaux sociaux.
Alixe, Manon, Charlotte, Selma, Anaïs, Elisa.
Photographies: Marnie Spasvevski-Lafoy.

